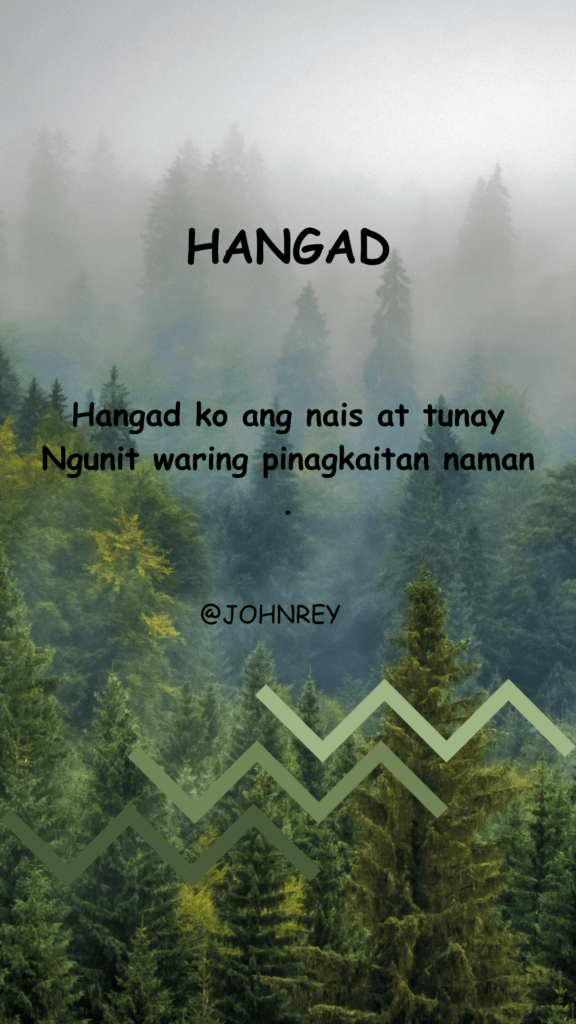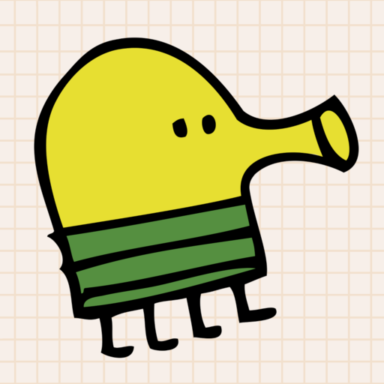Proiezione al « Nuovo » di Roma città aperta
Ma che colpo al cuore quando, su un liso
cartellone... Mi avvicino, guardo il colore
già d'un altro tempo, che ha il caldo viso
ovale dell'eroina, lo squallore
eroico del povero, opaco manifesto.
Subito entro : scosso da un interno clamore,
deciso a tremare nel ricordo,
a consumare la gloria del mio gesto.
Entro nell'arena, all'ultimo spettacolo,
senza vita, con grigie persone,
parenti, amici, sparsi sulle panche,
persi nell'ombra in cerchi distinti
e biancastri, nel fresco ricettacolo...
Subito, alle prime inquadrature,
mi travolge e rapisce... l'intermittence du cœur.
Mi trovo nelle scure vie della memoria,
nelle stanze misteriose
dove l'uomo fisicamente è altro,
e il passato lo bagna col suo pianto...
Eppure, dal lungo uso fatto esperto,
non perdo i fili : ecco... la Casilina,
su cui tristement si aprono
le porte della città di Rossellini...
ecco l'epico paesaggio neorealista,
coi fili del telegrafo, i selciati, i pini,
i muretti scrostati, la mistica
folla perduta nel daffare quotidiano,
le tetre forme della dominazione nazista...
Quasi emblema, ormai, l'urlo della Magnani,
sotto le ciocche disordinatamente assolute,
risuona nelle disperate panoramiche,
e nelle sue occhiate vive e mute
si addensa il senso della tragedia.
E lì che si dissolve e si mutila
il presente, e assorda il canto degli aedi.
Pier Paolo Pasolini La religione del mio tempo ed. Garzanti
Projection au cinéma « Nuovo » de Rome ville ouverte
Mais quel coup au cœur, quand, sur une
affiche défraîchie... Je m'approche, je regarde la couleur,
déjà d'un autre temps, du chaud visage ovale de l'héroïne, la misère héroïque de cette pauvre affiche opaque.
J'entre aussitôt : ébranlé par une clameur intérieure,
décidé à trembler dans le souvenir,
à consumer la gloire de mon geste.
J'entre dans l'arène, à la dernière séance,
sans vie, avec des personnes grises,
parents, amis, éparpillés sur les bancs,
perdus dans l'ombre en cercles distincts
et blêmes, dans le frais réceptacle...
Aussitôt, dès les premiers plans,
m'emporte et me ravit... l'intermittence
du cœur. Je me retrouve dans les rues sombres
mystérieuses où l'homme est physiquement autre,
et où le passé le baigne de ses pleurs...
Et pourtant, rendu expert par la longue habitude,
sur laquelle tristement s'ouvrent
les portes de la ville de Rossellini...
voilà le paysage épique du néoréalisme,
avec les fils du télégraphe, les pavés, les pins,
les murets décrépis, la foule mystique
perdue dans sa routine quotidienne,
sous ses mèches absolues et désordonnées,
résonne dans les panoramiques désespérés,
C'est là que le présent se dissout et se mutile
et que s'assourdit le chant des aèdes.
(Traduction personnelle)
Images : Roma, città aperta, [Rome, ville ouverte] de Roberto Rossellini